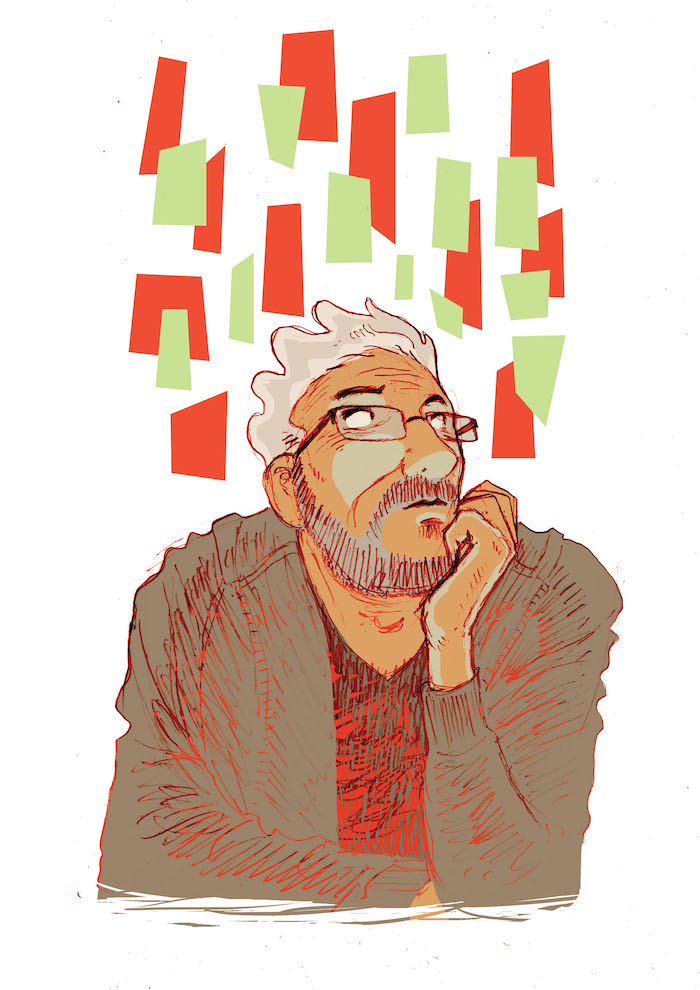Sandra n’apparaît-elle pas avant tout comme une bouée de sauvetage pour cette famille face au drame ?
Pour Elliott ce qui est assez beau c’est qu’au départ, il s’accroche à elle dans un instinct de survie, une sorte de nécessité vitale et c’est petit à petit que l’amour naît de cette rencontre. Pour Alex, il y a quelque chose au fond du même ordre, mais avec la panique en plus. Celle de se retrouver seul à élever ses enfants mais aussi seul face à son chagrin. La difficulté est de démêler l’affection nécessaire à rester en vie et l’amour véritable. Il est totalement embrouillé, il n’a aucun recul sur ce qu’il vit, contrairement à Sandra qui est plutôt dépassionnée parce que c’est son tempérament. Elle est plus cérébrale, elle a une capacité d’analyse des choses qui est souvent assez juste et qui lui permet de se tenir à distance et de se protéger en tous cas d’un point de vue affectif. Elle dit d’ailleurs : « Je suis seulement celle qui était là. »
Dans votre film, les personnages ne représentent pas une famille au sens traditionnel du terme, ils n’ont pas de liens du sang, ce sont des êtres qui choisissent de faire famille. N’est-ce pas ça l’amour ? Sortir du carcan imposé par les liens du sang pour aller vers un modèle plus libre ?
Je suis persuadée que les familles qu’on se choisit sont probablement bien plus solides que celles qu’on nous imposent par les liens du sang. Cependant, l’un n’empêche pas l’autre. Ce qui était important pour moi, c’est que Sandra, qui se revendique une certaine liberté et indépendance, n’arrive plus à lutter contre les liens d’attachement, mais que cela reste un choix qu’elle prend librement. Qu’il n’y ait pas de devoir comme on parlerait de devoir conjugal.
Par deux fois, vous mettez en scène Alex essayant de dialoguer à travers une vitre. Qu’est-ce que ça raconte ?
Dans ces deux scènes, ce ne sont pas les mots qui sont importants, c’est l’élan affectif qui prend le pas. A travers une vitre, l’essentiel se dit à travers les regards et en même temps ils sont protégés de trop d’effusions sentimentales. A ce moment du film, ils ne vont pas ou plus se prendre dans les bras, c’est autre chose qui se joue.
Lors d’une scène, David interprété par Raphaël Quenard dit à Sandra : « Les enfants s’adaptent, si tu disparais de sa vie aujourd’hui, il ne se souviendra pas de toi dans deux ans. » Qu’en pensez-vous ?
Il a probablement raison, si Sandra disparaissait de la vie des enfants, qu’est-ce qu’il resterait d’eux ? C’est très cruel, mais regardez-nous, à l’âge adulte, nous ne nous souvenons pas des gens qu’on a croisés étant petits. Et il est probable que cet enfant de cinq ans ne se souvienne quasiment pas de sa mère plus tard, ce qui est fou puisque c’est la personne qui est à l’origine de sa vie et de toute sa construction psychique depuis sa naissance… La mémoire est assez mystérieuse.
Même si l’on ne se souvient pas d’eux plus tard, les personnes présentes dans notre enfance ont tout de même un impact émotionnel sur notre construction.
Oui, un impact énorme. Je pense que c’est sans doute la mère d’Elliott qui a permis qu’il soit l’enfant qu’il est et l’adulte qu’il sera, mais cette mémoire-là est à mon sens plus de l’ordre de l’inconscient et de l’affectif que du cérébral.
Sandra évoque le fait d’avoir des enfants comme un don de soi, mais vouloir être parents n’est-ce pas aussi une forme d’égoïsme ?
C’est certainement un peu les deux. Pourquoi Sandra n’a-t-elle pas envie de s’attacher ni à un homme ni à un enfant ? Ce n’est pas parce qu’elles ne les aiment pas, je pense qu’elle se fait une idée trop haute de ce que c’est. Tant qu’on n’a pas d’enfants, on ne mesure pas à quel point c’est l’enfant qui nous fait devenir parent. C’est à l’épreuve du temps qu’on le devient. Chacun fait ses choix, j’ai pour ma part décidé de manière très personnelle, d’adopter mon enfant, car je n’avais pas envie de mettre un bébé au monde dans ce monde-là. Pour moi, il était plus simple psychiquement de savoir qu’un enfant quelque part pouvait avoir besoin d’une famille et que mon désir de maternité pouvait pallier le manque ailleurs. Il n’empêche que c’est le sens de la vie de faire des enfants, ce qui ne veut pas dire qu’il faut absolument en avoir, mais il y a une sorte d’élan vital, de besoin de se projeter dans la transmission qui fait que même les gens sous les bombes continuent à mettre des bébés au monde. Il y aurait quelque chose de mortifère à cesser.